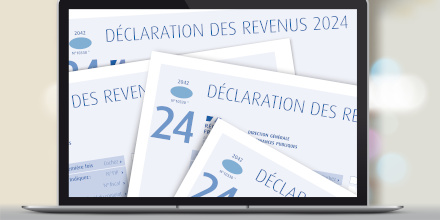Chaque année, les Français déboursent en moyenne 1 557 € pour des soins non remboursés et souvent ignorés des statistiques officielles. Zoom sur ces "restes à charge invisibles", un véritable angle mort de notre système de santé, aux conséquences parfois dramatiques.
Quels sont les soins non remboursés mais indispensables ?
Certaines dépenses de santé, qualifiées à tort de soins de confort, ne sont pas remboursées par l’Assurance maladie. Pourtant, elles s’avèrent cruciales pour la qualité de vie des malades.
L’exemple récent du vote à l’Assemblée nationale le 28 janvier 2025 illustre bien ce problème : les députés ont adopté à l’unanimité une loi pour la prise en charge intégrale de certains soins pour les femmes atteintes d’un cancer du sein (renouvellement de prothèses mammaires, perruque, soutien-gorge post-opératoire, etc.). Jusque-là, ces soins restaient à la charge des patientes.
Prenons l’exemple du vernis au silicium recommandé pour limiter les effets secondaires de la chimiothérapie : entre le produit protecteur (15€), le vernis foncé (10€) et la crème dissolvante (8 à 10€), la facture grimpe à 25 à 35€ par mois. Multipliez cela sur plusieurs mois de traitement : le coût devient conséquent, surtout pour les personnes sans mutuelle santé adaptée. Ces frais seront désormais pris en charge par l’Assurance Maladie
Dépenses invisibles de santé : 1 557 € par an, en moyenne
Selon une enquête de France Assos Santé publiée fin 2024, les restes à charge qualifiés d’invisibles, car ils passent sous les radars des statistiques officielles, atteignent 1 557€ en moyenne par an et par patient, avec des extrêmes allant jusqu’à 8 200€ pour les 10 % de malades les plus exposés.
On est loin, très loin du reste à charge moyen visible, estimé à 274€ par an et par assuré selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Cette différence s’explique par le périmètre d’analyse : la Drees ne prend en compte que les dépenses de santé répertoriées dans les bases de données officielles (consultations, médicaments, soins hospitaliers, analyses biologiques, imagerie médicale, soins d’optique, dentaires, et d’audiologie, etc.).
Les restes à charge invisibles (RACI), quant à eux, englobent des frais non codifiés ou considérés comme hors nomenclature, tels :
- les médecines douces ou alternatives (ostéopathie, acupuncture…)
- l’alimentation thérapeutique (compléments nutritionnels)
- les dépenses de transport
- l’adaptation du domicile ou de la voiture
- les soins de santé mentale non couverts
- les équipements ou accessoires spécifiques (gants, pansements, produits désinfectants…).
Un calcul rapide nous donne une addition annuelle de 1 831€ de restes à charge en santé, visibles et invisibles confondus. Rappelons que le Smic est de 1 801,80€ bruts en 2025.
Qui est le plus touché par ces frais de santé invisibles ?
Les personnes en affection longue durée (ALD)
Les patients atteints de cancer, de mucoviscidose, d’endométriose ou de douleurs chroniques sont particulièrement exposés. Par exemple :
- Les malades souffrant de douleurs chroniques dépensent en moyenne 1 972 € de RACI par an.
- Les femmes atteintes d’endométriose doivent assumer 149,61 € par an, en majorité pour des thérapies complémentaires (naturopathie, yoga, ostéopathie), sans aucun remboursement.
Les ménages modestes en première ligne
Plus de 53 % des patients interrogés déclarent renoncer à certains soins à cause de leur coût. Quant aux malades du cancer, 17% d’entre eux font face à des difficultés financières pour se soigner correctement.
Leur statut de patient ALD qui permet une prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie ne couvre pas la totalité de la dépense engagée : le remboursement intégral se fait toujours sur la base des tarifs conventionnés, éloignés des prix réels, et les dépassements d’honoraires ne sont jamais pris en charge, a fortiori les dépenses hors nomenclature.
Comment limiter les restes à charge invisibles ?
Les étudiants, les seniors et les travailleurs non salariés (TNS) sont pénalisés par rapport aux salariés qui bénéficient d’une mutuelle entreprise obligatoire, financée au moins à 50% par l’employeur. Les tarifs des mutuelles individuelles n’en finissent pas d’augmenter chaque année, au minimum 3+% par an, ce qui équivaut à la progression moyenne des dépenses de santé, et jusqu’à +10% comme en 2024.
Au coût de la couverture santé, s’ajoute celui des restes à charge visibles et invisibles. Heureusement, il existe des leviers pour réduire l’impact financier de ces dépenses non remboursées.
1. Respecter le parcours de soins coordonnés
Toujours passer par son médecin traitant pour consulter un spécialiste conventionné permet de bénéficier de meilleurs remboursements.
2. Utiliser le dispositif 100 % santé
Entrée en vigueur en 2021, la réforme 100 % santé supprime le reste à charge sur certains soins après intervention de l’Assurance Maladie et de la mutuelle responsable :
- optique (lunettes de vue, verres et monture)
- dentaire (prothèses, à savoir couronnes, bridges et dentiers)
- audiologie (appareils auditifs).
C’est un bon moyen de réduire significativement les frais visibles… mais insuffisant pour couvrir les RACI, comme les piles des aides auditives.
3. Bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire
La Complémentaire Santé Solidaire (CSS ou C2S) est une mutuelle gratuite ou à très faible coût pour les personnes modestes. Mais elle ne couvre pas tous les soins, notamment ceux jugés non essentiels ou de confort (ostéopathie, naturopathie, psychothérapie non conventionnée...).
Bon à savoir : en 2021, 44 % des personnes éligibles à la C2S n’en faisaient pas la demande, souvent par méconnaissance.
Faut-il changer de mutuelle pour mieux se couvrir ?
Pour les indépendants, retraités ou salariés mal couverts, une mutuelle plus protectrice, voire une surcomplémentaire santé, peut être une solution.
Exemples de remboursements pour les soins de confort :
- Ostéopathie : forfait de 200 à 500 € par an, ou 3 à 10 séances remboursées à hauteur de 15 à 50 € chacune.
- Acupuncture, diététique, psychologie : selon les contrats, ces soins peuvent être partiellement pris en charge.
Toutefois, plus la couverture est élevée, plus la cotisation mensuelle grimpe. Il n’est pas rare de dépasser les 100 € par mois pour une couverture optimale, en comptant mutuelle + surcomplémentaire. Le coût moyen d’une mutuelle senior s’élevait à 128€ par mois en 2024. Il est passé à 135€ en 2025 suite à l’inflation des tarifs.
Des aides ponctuelles existent aussi
Les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), la MSA (pour les agriculteurs), ou encore certaines associations de patients, proposent des aides financières ciblées, au cas par cas :
- participation à l’achat de matériel médical,
- financement de séances avec un psychologue ou un ergothérapeute,
- frais d’aide-ménagère liés à la maladie,
- aménagement du domicile pour les patients dialysés, etc.
Ces aides sont souvent conditionnées à la justification médicale et aux ressources du foyer.
Vers une meilleure reconnaissance des soins non remboursés ?
La loi votée en janvier 2025 pour les soins liés au cancer du sein marque peut-être un tournant. Il devient urgent de mieux intégrer les RACI dans les politiques de santé publique pour éviter des renoncements aux soins préjudiciables.
En parallèle, les mutuelles doivent également revoir leurs offres pour intégrer davantage de prestations jusqu’ici marginalisées, en particulier dans le champ du bien-être et de la santé mentale.
Ce qu’il faut retenir
- Les restes à charge invisibles représentent une dépense moyenne de 1 557 € par an pour les Français, bien supérieure aux chiffres officiels.
- Ils concernent surtout les soins non remboursés comme l’ostéopathie, les compléments alimentaires, les adaptations du domicile ou les thérapies psychocorporelles.
- Plus de la moitié des malades renoncent à ces soins, mettant en péril leur santé mentale, leur qualité de vie et parfois leur rétablissement.
- Des solutions existent : 100 % santé, C2S, surcomplémentaires, aides ponctuelles, mais elles nécessitent d’être mieux connues et mieux diffusées.